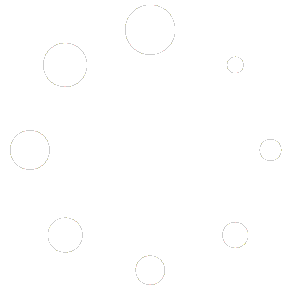L’emploi d’images générées par intelligence artificielle (IA) pour accompagner des articles soulève des questions complexes liées au droit d’auteur et à la législation sur la propriété intellectuelle. En s’appuyant sur les fondements du droit d’auteur traditionnel, notamment la nécessité d’une création humaine substantielle pour qu’une œuvre soit protégée, les IA, en tant qu’entités autonomes, sont exclues de cette protection. Cette approche s’inscrit dans la lignée de la théorie de l’auteur développée par des penseurs comme Walter Benjamin ou Roland Barthes, qui soulignent la dimension humaine et intentionnelle de l’acte créatif. Sur le plan réglementaire, la législation française et européenne évolue, avec des propositions visant à rendre obligatoire la mention explicite des images issues de l’IA afin de préserver la transparence et de limiter les risques de manipulation, conformément à des préoccupations éthiques et politiques sur l’authenticité des contenus numériques. Ces mesures rappellent les réflexions de Michel Foucault sur l’auteur en tant que fonction discursive, où l’éthique de la diffusion du savoir et des contenus trouve une nouvelle extension dans le contexte numérique. Enfin, les débats actuels dans l’Union européenne cherchent à équilibrer innovation technologique et protection des droits, illustrant un affrontement dialectique entre progrès technique et cadre normatif, à la croisée des philosophies pragmatistes et critiques.